Les Jurys
JURY LONGS MÉTRAGES

Séverine Ballon est compositrice et violoncelliste. Ces deux activités se nourrissent l’une l’autre dans la recherche musicale qu’elle mène. Pensionnaire à la Villa Médicis en 2023-2024, elle privilégie dans son travail les collaborations avec d’autres artistes, ainsi que des créations qui lient son engagement social à son travail artistique. Elle a publié deux albums solo, Solitude (2015) et Inconnaissance (2018), et composé pour le cinéma deux musiques originales pour João Pedro Rodrigues, L’Ornithologue (2016) et Où est cette rue ? Ou sans avant ni après (2022, coréal. avec João Rui Guerra da Mata). Ses dernières créations ont été jouées aux festivals Ultraschall Berlin, Donaueschinger Musiktage et Transit, ou encore à Radio France.
photo © Pauline Rühl Saur

Erika Balsom est lectrice en études cinématographiques au King’s College de Londres. Elle est également l’auteure de quatre livres parmi lesquels figurent After Uniqueness: A History of Film and Video Art in Circulation (2017) et Ten Skies (2021). Ses écrits sont apparus dans Cahiers du cinéma, Cinema Scope, e-flux, Grey Room, New Left Review et Screen avec d’autres publications. Elle est co-éditrice de Documentary Across Disciplines (2016) et de Feminist Worldmaking and the Moving Image (2022), ainsi que co-programmatrice de “Peggy Ahwesh: Vision Machines” (Spike Island, Bristol/Kunsthall Stavanger, 2021-22) et de “No Master Territories: Feminist Worldmaking and the Moving Image” (HKW Berlin/Museum of Modern Art, Varsovie, 2022-23).

Lucile Hadzihalilovic est cinéaste. Au début des années 1990, elle fonde avec Gaspar Noé la société de production Les Cinémas de la Zone et tous deux travaillent en collaboration sur plusieurs films. En 1996, elle produit, écrit, réalise et monte le moyen-métrage La Bouche de Jean-Pierre, sélectionné à Un Certain Regard, au festival de Cannes. En 2004, son premier long-métrage Innocence, reçoit le prix du meilleur premier film au festival de San Sebastian. En 2015, Evolution obtient le Prix Spécial du Jury et le Prix de la meilleure photographie à San Sebastian. En 2022, Earwig obtient de nouveau le Prix Spécial du Jury à San Sebastian. Son 4e film, La Tour de Glace, est sélectionné en compétition officielle à la Berlinale en 2025.

Le réalisateur, enseignant et programmateur Carlos Muguiro est le fondateur et directeur de la Elías Querejeta Zine Eskola (EQZE), un centre international de réflexion, de recherche et de pratique expérimental consacré au cinéma d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Il est également docteur en sciences humaines à l’université Pompeu Fabra de Barcelone et en réalisation cinématographique à l’ECAM de Madrid. Il réalise, avec Sergio Oksman, Goodbye, America en 2007, Notes on the Other en 2009, Une Histoire pour les Modlin en 2012 et O futebol en 2015. Chercheur invité au département des études slaves de l’université de Cambridge, il a édité plusieurs publications, dont : Ver sin Vertov. (1955-2005) Cincuenta años de no ficción en Rusia y la URSS ; Ermanno Olmi. Siete encuentros y otros instantes.
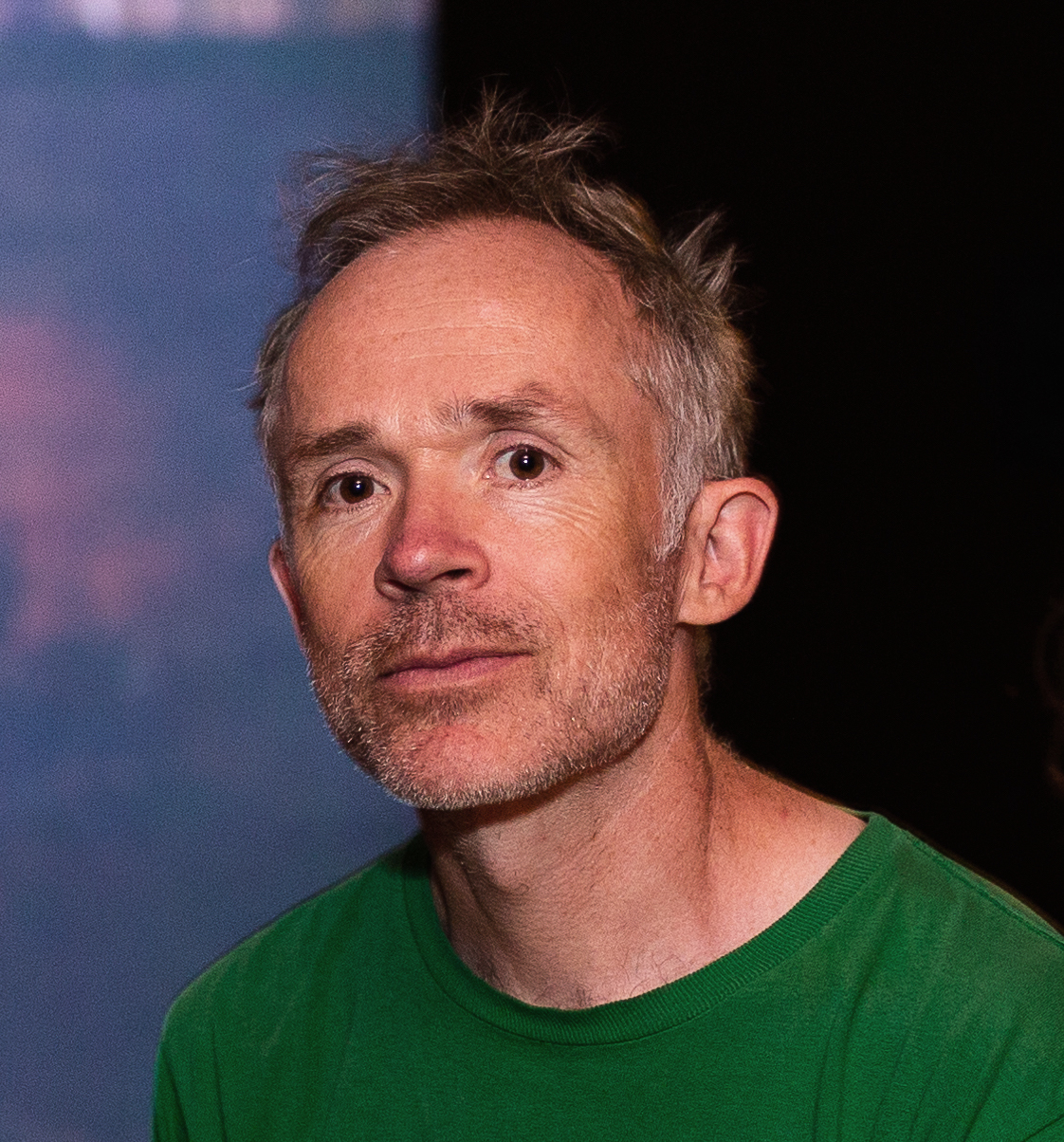
Ben Rivers a réalisé près de quarante films. Ses films se frayent un chemin entre documentaire et fiction, portant majoritairement sur des personnes qui se sont écartées d’une certaine manière d’une société ordinaire, créant ainsi des narrations indirectes qui mettent en scène des existences alternatives. Il a remporté de multiples récompenses telles que le prix EYE Art & Film et le prix International Critics de la FIPRESCI (Fédération Internationale de la Presse Cinématographique), récompensé également au 68ème Festival international du film de Venise (ou Mostra de Venise) pour son premier long métrage Two Years at Sea. Il a récemment achevé une suite à Two Years at Sea intitulée Bogancloch.
photo © Lisa Whiting Photography
JURY COURTS MÉTRAGES ET PREMIERS FILMS

Pablo Alvarez-Mesa est un cinéaste, directeur de photographie et monteur travaillant principalement dans le documentaire et dont les films ont été présentés et récompensés dans des festivals internationaux comme la Berlinale, l’IFFR, la Viennale, le MoMA et le RIDM. Ses travaux cinématographiques portent sur la relation entre les faits et la fiction : entre ce dont on se souvient et ce qui est inéluctablement élaboré. Pablo est boursier du Sundance Doc Fund, membre affilié du Centre for Oral History and Digital Storytelling de l’Université Concordia, et ancien élève de Berlinale Talents, du Banff Centre for the Arts et du Centre canadien du film.
photo © Léa Rener

Marilou Duponchel est critique de cinéma aux Inrockuptibles et chez Trois Couleurs. Elle a été membre du comité court métrage de la Semaine de la Critique puis du comité long jusqu’en mai 2024. Elle a par le passé programmé et présenté un ciné-club consacré au court métrage, le Ciné-Court des Inrocks. Elle écrit désormais dans les colonnes de la revue Bref, consacrée à ce format.

Kaori Kinoshita est artiste plasticienne et cinéaste. Née à Tokyo, elle vit et travaille en France. Elle a co-réalisé avec Alain Della Negra de nombreux films courts et trois longs métrages sortis en salle (The Cat, the Reverend and the Slave en 2010, Bonheur Académie en 2017) ou diffusés sur Arte (Petit ami parfait, la Lucarne, en 2021). En jouant avec des dispositifs proches du cinéma-vérité, ils transforment les artifices de la fiction en outils documentaires. Leurs installations sont montrées dans des centres d’art et musées tels que le Centre Pompidou, le Palais de Tokyo ou le Musée d’Art Moderne de la ville de Paris. À Cinéma du réel en 2018, ils ont présenté Tsuma Musume Haha, moyen métrage explorant une histoire d’amour non réciproque entre humains et non-humains au Japon.

Économiste, producteur et PDG de O Som e a Fúria, Luís Urbano est membre de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, de l’European Film Academy et de l’European Producers Club. En 2020, il a reçu le prix de coproduction Eurimages/EFA. Depuis 2005, il a produit plus de 60 films, incluant longs-métrages, courts-métrages et documentaires. Parmi ses productions notables figurent les deux derniers films de Manoel de Oliveira, les longs-métrages acclamés de Miguel Gomes (Tabou, Les Mille et Une Nuits et Journal de Tuôa) et, plus récemment, Bad For a Moment, de Daniel Soares.

Ulrich Ziemons est programmateur de films et de festivals basé à Berlin. Il est à la tête de la section Forum Expanded du Festival international du film de Berlin. Il a sélectionné des programmes de films pour des festivals internationaux de cinéma et des institutions artistiques. Son livre Aufzeichnungen eines Stormsquatters a été publié en 2014.
photo © Guillaume Cailleau
JURY DU PRIX CLARENS DU DOCUMENTAIRE HUMANISTE

Né en 1989 à Paris, Hadrien Frémont a étudié les Arts Plastiques à la Sorbonne, Master « Espaces, lieux, expositions, réseaux ». Il a poursuivi son parcours à l’IESA Arts et Culture où il obtient le titre d’Expert en commercialisation et diffusion des œuvres d’art contemporain. Il effectue depuis fin 2020 des missions pour la Fondation Clarens pour l’Humanisme, qui s’attache à promouvoir toute activité visant à redéfinir dans les termes contemporains les valeurs humanistes. Il en exprimera la voix et la vision dans ce jury du Prix Clarens du Documentaire Humaniste.
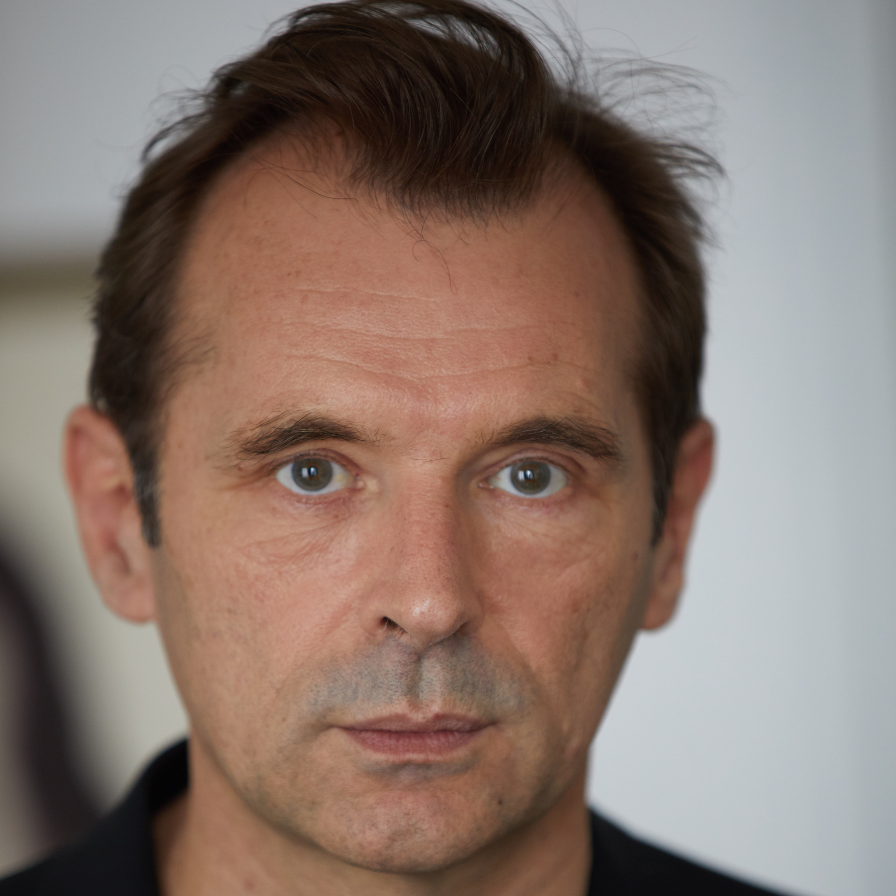
Après un cursus universitaire effectué à Bordeaux, Xavier Marquier s’est orienté vers le spectacle vivant, la musique, le jazz en particulier. Il a plus tard eu l’opportunité, après un bref parcours de musicien, d’écrire à propos de cette musique et de produire quelques artistes. C’est finalement par l’écriture qu’il arrivé à l’image et à la réalisation. Il a développé cette activité sur tout types de support et formats en réalisant des reportages, des captations, en écrivant de projets de documentaires et de fictions.

Anne Morin est engagée dans le documentaire depuis une trentaine d’années. Elle réalise des films : Mes toits et moi, histoire de maisons familiales vue aux festivals de Locarno, Buenos Aires ou bien Trieste ; C’est toujours la même histoire, film en animation parti aux festivals d’Ottawa, Sao Paulo ou Liepzig ; Rififi dans le tiroir, histoire burlesque et poétique d’une adoption primée aux Ciné Rencontres et au New Delhi Film Festival. Rédactrice, Anne Morin contribue aussi à l’écriture de projets documentaires et a longuement collaboré à Arte dans la sélection des projets documentaires.

Née au Liechtenstein, Ina Seghezzi a travaillé, après des études de théâtre, cinéma et lettres à l’Université de Vienne et à Paris, comme metteuse en scène, collaboratrice à la mise en scène et dramaturge au théâtre et à l’opéra. En 2004, elle suit une formation à la réalisation documentaire aux Ateliers Varan à Paris et réalise son premier court-métrage, Chair de ta chair. Depuis elle a réalisé les films documentaires minimal land (2007), Stéphane Hessel, une histoire d’engagement (2008), Avenue Rivadavia (2012), insomnies (2015), Histoires de la Plaine (2017), Les cavaliers fantômes (2019), Oussama (2022)… Ina Seghezzi est membre des Ateliers Varan et y intervient comme formatrice à la réalisation documentaire, tout comme à l’Université Paris Cité et l’Esec.

Comment continuer à vivre, après, lorsqu’on a grandi sous la dictature, lorsqu’on s’est construit sous la dictature, lorsqu’elle fait partie de nous – malgré tout ? Creuser là où cela fait mal, c’est ce que Vanina Vignal a fait en Roumanie pour ses premiers films (Stella, Dimi, Après le silence) et pour ses films en cours : en France (conséquences de l’inceste sur 8 générations de sa famille paternelle / colonisation française au 19ème siècle à partir des archives de son aïeul “explorateur-pacificateur”), et en Allemagne (sur les frontières et sa propre (non)-liberté). Son activité de cinéaste comprend également des interventions autour du cinéma documentaire en France et en Roumanie, elle est traductrice de films et programmatrice : après l’ADDOC, l’ACID et ACID Cannes, elle fut dernièrement co-directrice artistique, avec Andrei Rus, du Festival International de Films Documentaires et des droits de l’Homme ONE WORLD ROMANIA.
JURY DES JEUNES
Le Jury des Jeunes remet le Prix des Jeunes – Ciné+ Festival à un long métrage de la compétition. Les six membres du Jury des Jeunes sont accompagnés cette année par Sylvie Larroque.








Après une première expérience comme programmatrice au Ciné 104 de Pantin, Sylvie Larroque a pris en 2006 la codirection de L’Atalante à Bayonne, cinéma indépendant de trois salles, connu pour sa politique d’animation active et membre du réseau Europa cinémas. Elle organise aussi au sein du cinéma l‘événement annuel Rencontres sur les Docks, consacré majoritairement au cinéma documentaire.
JURY DES BIBLIOTHÈQUES

Marie-Pierre Brêtas passe une partie de son enfance à Toulouse, ainsi qu’à Oran, post-indépendante, et à Thiais, en banlieue parisienne. Après une hypokhâgne, elle devient journaliste au Matin, part à New York où elle enchaîne les petits boulots : femme de ménage, cuisinière au Chelsea Hôtel, assistante déco. De retour à Paris, elle se lance dans la réalisation en autodidacte puis se forme aux Ateliers Varan. Elle co-réalise pour Arte Mon travail c’est capital, tourne dans le Nordeste brésilien La campagne de Saõ José, sélectionné au FID et Grand Prix du Fidadoc, puis Hautes Terres, mention spéciale du Jury à Cinéma du réel en 2014. Ses deux derniers films sont en compétition à Cinéma du réel : La lumière des Rêves en 2022 et Leaving Amerika, en 2024.

Ses études de lettres et son goût pour les livres ont conduite Christelle Bernard à travailler en bibliothèque : tout d’abord pendant 20 ans en section livres adultes dans une bibliothèque municipale et départementale. Elle a alors découvert les films documentaires et apprécié leur diversité si différente de la télévision, des salles de cinéma ou des plateformes. Puis, elle a satisfait son appétence pour le cinéma en s’occupant de la vidéothèque de la Médiathèque départementale du Territoire de Belfort. En plus du fonds de DVD, dans ce département, les documentaires sont valorisés au cours du Prix du Public-Les Yeux doc en mars, organisé par la Bpi et du Mois du film documentaire en novembre, initié par Images en bibliothèque.

Chargé de collections et médiateur au sein des sections Sciences & techniques et Arts de la bibliothèque Alexis de Tocqueville, Benjamin Genissel a étudié le Cinéma documentaire à Paris 7 Denis Diderot. Il contribue comme critique et intervieweur au Blog documentaire depuis sa création en 2011. En 2024, il a participé avec la Bpi au cycle de programmation “Les yeux doc à midi” au centre Pompidou. Il est par ailleurs photographe et auteur d’un essai sur “L’Inde fantôme” de Louis Malle.

Après 25 ans en tant que discothécaire dans l’espace musique d’un Médiathèque d’un grand réseau de l’ouest francilien, Hélène Kretschmar a intégré la Médiathèque municipale de Vélizy-Villacoublay en tant que responsable Musique et Cinéma depuis 2018. Cette médiathèque, ouverte en 1985, comportait déjà à son ouverture une vidéothèque de consultation, et possède un fonds d’environ 5.000 DVD dont un quart de films documentaires. Grande fan du cinéma documentaire depuis sa découverte du film Reporters de Raymond Depardon à la fin des années 80, elle a développé le fonds de films documentaires et mis en place la participation de la médiathèque au Mois du film documentaire tous les ans au mois de novembre.
JURY ROUTE ONE/DOC

Arrivée dans l’équipe de La Cinémathèque du documentaire à la Bpi en 2018, Marion Bonneau y est programmatrice depuis 2022. Elle y a mené, entre autres, un hommage à la cinéaste allemande Helga Reidemeister, une exploration du cinéma documentaire canadien et de ses représentations autochtones, une rétrospective de l’œuvre de Claire Simon, un cycle revenant sur cinquante ans de luttes collectives et féministes à partir du fonds du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir… Elle prolonge ce geste de transmission en intervenant ponctuellement dans l’enseignement supérieur (DEMC, La Fémis, Paris 8).
photo © Victor Calsou

Après des études d’Anthropologie, Agnès Jahier s’engage dans plusieurs projets associatifs pour transmettre les connaissances de cette discipline et travailler à la diffusion du cinéma documentaire. Depuis 2018, elle dirige Périphérie, association dédiée au cinéma documentaire qui soutient la création, à travers l’accueil de cinéastes en résidences, des ateliers d’éducation à l’image et les rencontres annuelles du cinéma documentaire.

Stéphane Mercurio filme des sans domicile dans Cherche avenir avec toit, des familles de détenus dans A côté, son premier film sur l’enfermement). Elle fera une trilogie sur la prison. A chaque projet, des expérimentations : la photographie dans A côté, A l’ombre de la république et Quelque chose des hommes. Avec Christophe Otzenberger, elle réalise Petits arrangements avec la vie, le dernier film du réalisateur qui se sait condamné. Elle tourne et monte seule, en toute liberté, une « balade documentaire » intitulée Les parisiens d’août publiée quotidiennement. Avec Les habits de nos vies, dans un décor, des gens se racontent au travers d’un vêtement. En 2024, Le Cinémathèque du documentaire de la Bpi lui consacre une rétrospective au Centre Pompidou : Stéphane Mercurio, la parole aux invisibles.

Après des études d’histoire et de cinéma, Raphaël Pillosio a produit de nombreux documentaires au sein de l’Atelier documentaire, société installée à Bordeaux, fondée avec Fabrice Marache en 2007. Parmi les derniers films qu’il a produits : Ana Rosa de Catalina Villar, À pas aveugles de Christophe Cognet, Le fleuve n’est pas une frontière d’Alassane Diago, Mon pire ennemi et Là où Dieu n’est pas de Mehran Tamadon, Thun-le-paradis d’Eleonor Gilbert, L’Évangile de la Révolution de François-Xavier Drouet. Comme réalisateur, il a consacré trois films aux mondes des Gens du voyage : Route de Limoges, Des Français sans Histoire et Histoires du carnet anthropométrique. Après Algérie, d’autres regards, un documentaire consacré aux cinéastes qui s’étaient engagés contre la guerre d’Algérie, Les mots qu’elles eurent un jour poursuit son exploration des liens entre le cinéma militant et l’Algérie.
photo © Léa Rener

Pierre Tonachella vit à Paris. Il réalise des films documentaires (dont Jusqu’à ce que le jour se lève en 2017, Longtemps, ce regard en 2023) et écrit, des articles, des scénarios, de la poésie. Il travaille la façon dont les liens, intimes et politiques, se font et se défont à travers le temps, et comment l’idée d’une communauté rêvée traverse l’Histoire.
photo © Léa Rener
JURY PRIX PRÉLUDES

En 1980, Claudine Bories réalise son premier film Juliette du côté des hommes, sélectionné au Festival de Cannes 81 (Perspectives du cinéma français). Ce film obtient le Prix Préludes en 2023 au Cinéma du réel. Entre 1983 et 2002 , elle dirige Périphérie, Centre de Création consacré au cinéma documentaire. En 1992, elle participe à la fondation de l’ACID pour la diffusion du cinéma indépendant. En 1994 elle co-fonde l’ ADDOC, lieu de réflexion des cinéastes documentaristes. C’est là qu’elle rencontre Patrice Chagnard. À partir de 1995 ils collaborent aux films l’un de l’autre. Ils coréalisent depuis 2005. Elle a notamment réalisé Juliette du côté des hommes, La fille du magicien, Monsieur contre Madame, Les Arrivants, Les règles du jeu, Nous le peuple et Vedette.

Thomas Carillon, président fondateur de Préludes

Thomas Choury a travaillé au sein de plusieurs festivals comme la Semaine de la critique, l’ACID et – depuis 2022 – Cinéma du réel, pour lequel il coordonne plusieurs programmations du volet professionnel ParisDOC, dont les Matinales, le Forum Public et les Rendez-vous du Documentaire de Patrimoine. Par ailleurs, il a régulièrement publié des textes dans les revues Critikat et Trois Couleurs et poursuit, actuellement, une thèse en Recherche-Création à l’ENS, dans le cadre du programme SACRe, intitulée Éclats du direct sportif.

Né à l’ombre du Théâtre du Peuple de Bussang, Bruno Deloye débute sa carrière au sein de Région Câble en tant que directeur adjoint du développement et lance en particulier la première chaîne de Pay per View en France en 1991. Il rejoint le groupe MCM-Euromusique pour prendre en charge la création en 1995 de la première chaîne de télévision dédiée à la musique classique et au Jazz « Muzzik ». En 2000, il entre à Canal+ Thématique, ou il occupera successivement les fonctions de directeur de Ciné + Classic en France, Espagne & Italie. Aujourd’hui il est directeur des chaînes Ciné + Festival dédiée au cinéma d’auteur et aux talents émergents, et de Ciné + Classic dédiée au cinéma de répertoire.

Diplômée d’une Licence de Cinéma et d’Histoire de l’art à La Sorbonne et d’un Master Patrimoines Audiovisuels à l’INA, Louise Gerbelle s’investit dans différentes structures comme la Cinémathèque Française, Potemkine Films et la plateforme Le Cinéma Club à New York. Dès 2019, elle se spécialise dans la coordination de festivals et la programmation, après plusieurs années au sein de l’équipe de la Fête du court-métrage et du Festival Off-Courts à Trouville, ainsi que de la sélection Cannes Classics du Festival de Cannes. Aujourd’hui, elle est chargée de diffusion pour la plateforme Préludes, et continue son activité de programmation, notamment pour l’Aegean Film Festival en Grèce.
JURY DES DÉTENUS DE LA MAISON D’ARRÊT DE BOIS-D’ARCY
Le jury des détenus de la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy est composé d’une dizaine de personnes détenues et de deux personnes de la société civile, Célimène Marracci, étudiante en études politiques à l’EHESS, et Pablo Bernal Torres, qui vient d’achever une formation en réalisation documentaire aux Ateliers Varan.
JURY DU PUBLIC
Cette année afin de désigner le prix du public première fenêtre, les cinq films qui auront reçu le plus de voix sur Mediapart seront soumis à un jury de spectateurs.
Ce jury est composé de personnes issues de deux associations partenaires du festival, le Centre d’hébergement Emmaüs Pereire et Aurore, qui ont participé à un atelier de réalisation proposé par Les Yeux de l’Ouïe en amont du festival.
Il s’agit de Claude Bloin, François Gadois, Joelle Breyton, Nourad Ait Amer, Sylvain Letourneur, Valérie Caret, Vanessa Micoulaud, Bénédicte Exbrayat-Kessler, Philippe Cabannes, Wilfried Dossou, Jean-Yves Bienaimé, Lahouari Djellouli, Macéo Soualem et Landrile Ngongang.